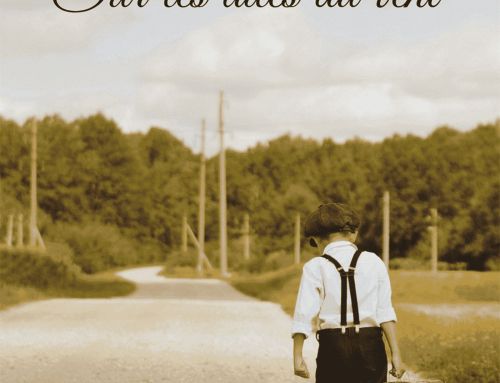Description du projet

Bruxelles, 10 mai 1940
Le vrombissement incessant des avions nous réveille dans la nuit. Je regarde le cadran de l’horloge près de mon lit. 3 heures 12. C’est l’invasion de la Belgique par les Allemands. Lorsque le jour se lève, on assiste à des scènes d’affolement et débandades dans la rue. Je suis descendue chercher du pain. Des autos s’éloignent en trombe des garages derrière chez nous. Tous les gens que je croise se pressent, hagards. J’interroge un homme.
— Les troupes allemandes avancent à travers les Ardennes. Vous devriez partir au plus vite.
Quelques heures plus tard et durant les trois jours qui suivent, j’observe de la fenêtre de plus en plus de familles avec baluchons et valises qui quittent précipitamment leurs logements. La promesse de neutralité qu’on nous a faite n’est plus respectée. Cette nouvelle cause un vent de panique dans la population.
⁂
Mardi 14 mai 1940. Le bruit court que les troupes allemandes ont réussi à traverser le canal Albert dans la province de Liège. Le fort d’Ében-Émael réputé imprenable est passé aux forces ennemies qui s’approchent maintenant de Liège. Depuis hier, des officiers belges basés à Bruxelles entassent famille et bagages dans leur voiture, ficelant des matelas sur le toit. L’armée, en pleine déroute, se soustrait lâchement à ses devoirs. La fuite me semble inéluctable. Avec Maman, nous décidons de partir vers le nord de la France par le train. Nous emmenons ce qui a de la valeur – notre argenterie et le renard de Maman – ainsi que quelques vêtements, une couverture, et de la nourriture. Guy n’a que cinq ans et demi et il nous faudra parfois aussi le porter. Nous comptons, comme beaucoup, pouvoir rejoindre la sécurité qu’offre l’Angleterre. Encore un exil vers une terre étrangère.
Une foule compacte grouille dans la gare. Tous ces gens veulent désespérément monter dans un train vers l’ouest ou le sud du pays. Les affres de la terreur apparaissent, presque palpables, sur le visage de ces milliers d’inconnus. Peur de mourir, peur de s’éteindre à petit feu de l’intérieur, peur des atrocités que les Allemands font subir et dont on a entendu parler, peur de la torture, peur pour nous, mais surtout pour ceux qu’on aime. Habitée par cette angoisse, je suis déterminée à lui échapper. Je pense à Papa et je me sens soudain emplie de courage.
Après des heures d’attente, et dans la cohue, nous parvenons in extremis à prendre un train en direction de Dunkerque. Nous sommes des dizaines et des dizaines massés dans des wagons en bois, entassés tel du bétail, même dans les couloirs. Je dois jouer des coudes pour que Maman puisse bénéficier d’un peu d’air provenant d’une fenêtre entrouverte. Elle est blanche comme un linge. Le trajet nous paraît interminable.
— Maman, j’ai envie de faire pipi, réclame Guy.
— Retiens-toi, c’est impossible ici.
Je réplique plus brusquement que je ne le voudrais. Culpabilisant, je lui remets doucement sa mèche blonde en place, en lui caressant le front.
Finalement, les gens commencent à s’agiter autour de nous, signe de l’arrivée imminente à notre destination. Ce n’est pas Dunkerque, mais Poperinge. Le chef de station annonce que le train n’ira pas plus loin aujourd’hui. C’est le chaos pour sortir de la gare. Dehors, un long flux de personnes se forme. Tous marchent dans la même direction. Vers la frontière française. La nuit est tombée. Nous nous trouvons encore à plus de trente-cinq kilomètres de Dunkerque. Impossible d’imposer ça à Maman et mon petit. Nous avons besoin de dénicher une chambre. Une vieille dame toute maigre à qui il manque presque toutes ses dents s’approche de nous. Elle nous propose, contre monnaie trébuchante, de loger chez elle. Nous n’avons pas vraiment le choix. Elle nous conduit dans sa maison, puis nous montons dans son grenier poussiéreux, où trône un lit en fer forgé avec un matelas dessus. Elle pose un drap râpé sur la couche tachée. Nous nous allongeons tous les trois avec réticence. J’enveloppe Maman et Guy de la chaude couverture aux motifs arabes ramenée dans nos bagages d’Algérie. Des punaises nous dévorent toute la nuit, je ne ferme quasiment pas les yeux, fixant les toiles d’araignée sur la charpente. Je prie : Papa, si tu en as le pouvoir, protège-nous. Veille sur ta famille et donne-nous la force d’affronter toutes ces épreuves.
Extrait d’un roman d’inspiration biographique écrit en 2022